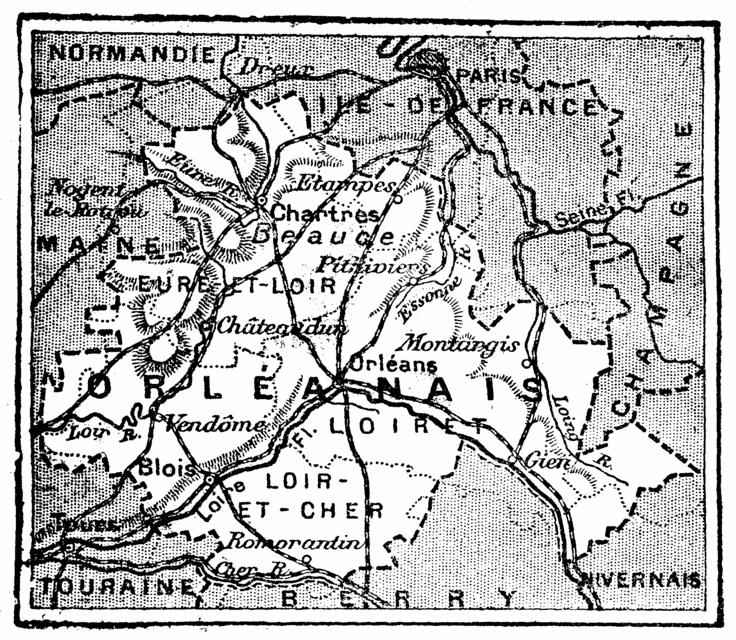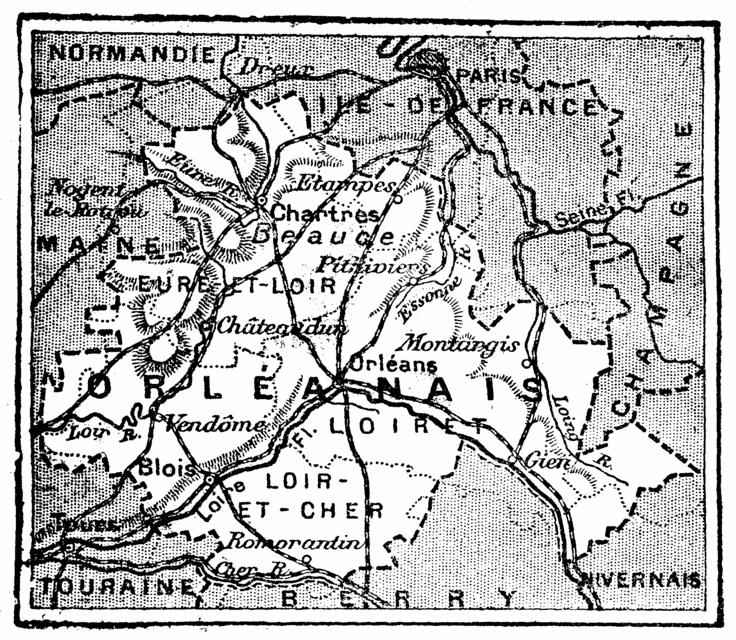CXVIII. – La ferme du père Guillaume dans
l'Orléanais. – Les ruines de la guerre.
Les maux de la guerre ne finissent point avec elle :
que de ruines elle laisse à sa suite quand elle a passé quelque
part !
Quelques heures après
être partis de Paris, et après avoir traversé Chartres, nos
voyageurs descendaient du chemin de fer. Ils laissèrent dans la petite
gare leurs caisses de voyage ; puis, munis seulement d'un paquet
léger et d'un bâton, ils suivirent à pied la route qui
menait à la ferme de la Grand'Lande, située dans la partie la plus
montueuse de l'Orléanais.
Ils marchèrent assez longtemps le long d'une jolie
chaîne de collines au pied desquelles serpentait la rivière. Ils
suivaient un sentier étroit, déjà ombragé par les
feuilles naissantes des arbres ; au-dessus d'eux les oiseaux chantaient
dans les branches, fêtant le prochain retour du printemps. Julien, plus
gai encore que les pinsons qui gazouillaient autour de lui, sautait de joie en
marchant : – Oh ! disait-il, quel bonheur ! Nous allons
donc être tous réunis, et puis nous allons vivre aux
champs !...
André partageait en lui-même la joie de
Julien ; l'oncle Frantz se sentait aussi tout heureux à la
pensée de revoir son vieil ami le pilote Guillaume et de s'installer
auprès de lui avec ses deux enfants d'adoption.
CARTE DE L'ORLÉANAIS. – C'est dans
l'Orléanais que se trouvent les plaines fertiles de la Beauce,
surnommées les greniers de Paris. Par malheur, vers le sud,
l'Orléanais renferme des plaines stériles et marécageuses.
La ville la plus importante est Orléans (66 700 hab.). Viennent
ensuite Chartres (23 000 hab.), qui fait un grand commerce de
blé ; Blois (23 500 hab.), sur la Loire, célèbre
par son ancien château et ses souvenirs historiques ; Vendôme,
sur le Loir, Châteaudun est célèbre par sa défense
héroïque contre les armées allemandes.
Ils
marchaient depuis une bonne demi-heure et n'avaient encore rencontré
personne à qui s'informer du chemin ; ils craignirent de
s'être égarés. Afin d'apercevoir mieux le pays, ils
montèrent sur un talus, et Julien distingua, à deux cents pas de
là, derrière une haie, trois petites filles accroupies par terre,
un couteau à la main, en train de cueillir de la salade sauvage. Il les
appela pour qu'elles leur indiquassent le chemin. Sa voix fut plusieurs fois
répétée par un bel écho de la colline ;
malgré cela, les trois petites filles étaient si occupées
à leur besogne qu'elles n'y firent point attention.
– Mon oncle, dit alors Julien, je vais descendre la
colline et courir près d'elles pour leur demander le chemin.
L'enfant courut en avant et s'approchant des trois petites,
qui avaient levé la tête en l'entendant crier :
– Est-ce que la ferme de la Grand'Lande est loin
d'ici ? leur demanda-t-il.
– Oh ! non, répondit l'aînée,
dans cinq minutes on est chez nous.
– Chez vous, reprit Julien en regardant les trois
enfants de tous ses yeux ; mais alors vous êtes donc les petites
filles de M. Guillaume ?
– Mais oui, répondirent-elles à la
fois.
– Et nous, s'écria le petit garçon tout
joyeux, nous sommes ses amis et nous venons le voie. Peut-être bien vous
a-t-il parlé de nous déjà : je m'appelle Julien
Volden, moi, et je sais votre nom à toutes les trois : tenez, vous
qui êtes grande comme moi, vous vous appelez Adèle, dit Julien en
désignant l'aînée des petites, vos deux soeurs, Marie et
Louise, sont jumelles, elles ont cinq ans.
LA FERME RAVAGÉE PAR LA GUERRE. – La guerre
est toujours un grand malheur pour les peuples, que qu'en soit le
résultat, et les vainqueurs souvent n'y perdent pas moins que les
vaincus. La où les batailles se livrent, les campagnes sont
dévastées : la vie entière dans tout le pays est
suspendue, le commerce est arrêté et ne reprend ensuite qu'avec
peine. Néanmoins, quand la Patrie est attaquée, c'est à ses
enfants de se lever courageusement pour la défendre ; ils doivent
sacrifier sans hésiter leurs biens et leur vie.
La petite Marie se mit à
sourire : – Notre père nous a parlé de vous aussi,
Julien, dit-elle ; il vous aime beaucoup.
Et les trois enfants regardèrent Julien avec
intérêt, comme si la connaissance était désormais
complète entre eux.
Julien, enchanté, reprit aussitôt :
– Vous devez être bien contentes à présent d'avoir une
ferme et de vivre aux champs ? Moi, j'aime les champs comme tout,
savez-vous ? Et les vaches, et les chevaux, et toutes les bêtes
d'abord !
Le visage des petites filles s'était assombri.
L'aînée poussa un gros soupir et ne répondit rien. La jeune,
Marie, plus expansive que ses soeurs, s'écria tristement :
– Oh ! Julien, nous avons beaucoup de peine, au
contraire. Il y a sur la ferme des charges trop dures, à ce que dit
papa ; et puis, pendant la guerre, les bâtiments ont
été à moitié détruits ; rien n'est
ensemencé. Alors papa dit : « Il vaut mieux que je m'en
retourne sur mer ! » et maman pleure.
L'enfant, qui avait exposé la situation tout d'une
haleine, s'arrêta d'un air découragé.
La petite figure de Julien s'attrista à son tour. En
ce moment, l'oncle Frantz et André arrivèrent, et on se dirigea
vers la ferme.
Chemin faisant, chacun observait la campagne, en
réfléchissant aux paroles désolées de la
petite.
Bientôt on vit se dessiner au pied de la colline,
derrière quelques noyers mutilés, les bâtiments de la
ferme.
– Hélas ! s'écria Julien en
joignant les mains avec tristesse, pauvre maison ! elle est presque
démolie : il y a des places où il ne reste plus que les
quatre murs tout noirs avec des trous de boulets. Je vois qu'on s'est battu ici
comme chez nous : il me semble que je reviens à Phalsbourg.
Et, tout en marchant, Julien réfléchissait aux
malheurs sans nombre que la guerre entraîne après elle partout
où elle passe.